Épisode 2 : Centralisation et lourdeurs administratives – Le frein invisible à la réindustrialisation
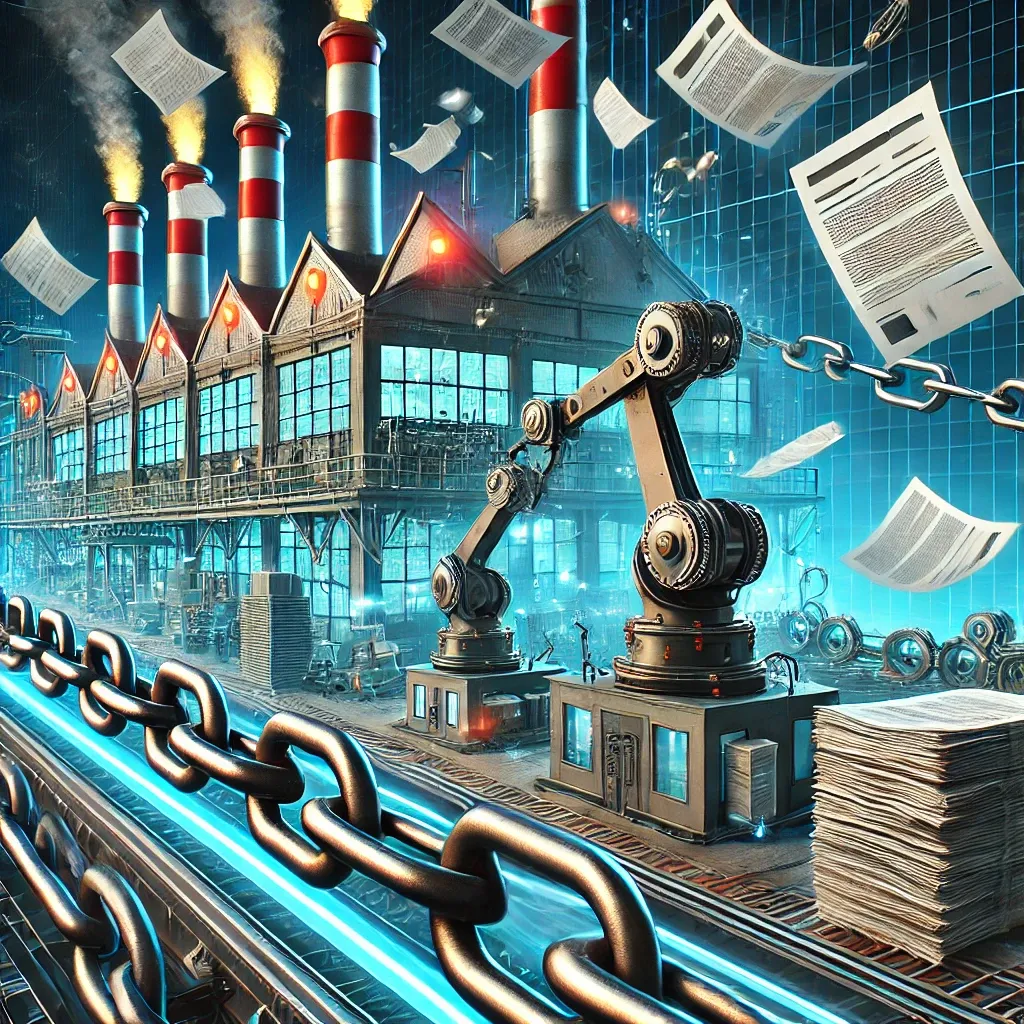
Des décisions trop centralisées
Un obstacle majeur à la renaissance industrielle française tient à l'excès de centralisation. Traditionnellement, beaucoup de décisions industrielles se prennent à Paris, dans les ministères et l’administration centrale, loin du terrain. Les collectivités locales – régions, départements, intercommunalités – disposent de marges de manœuvre limitées pour attirer et faciliter l’implantation d’usines. Lorsqu’il s’agit d’implanter une nouvelle usine, les élus locaux ne peuvent pas prendre seul la décision. Il doivent obtenir une série d’autorisations délivrées par l’État, ce qui dilue les responsabilités et freine les prises de décision. En conséquence, chacun hésite à assumer la responsabilité d’un projet, ce qui ralentit son aboutissement. Cette centralisation excessive éloigne les décisions des réalités locales et impose des règles uniformes, souvent inadaptées aux spécificités de chaque territoire. Cette concentration du pouvoir décisionnel ralentit les projets et les éloigne des réalités locales. Les règles uniformes décidées au niveau national ne tiennent pas toujours compte des spécificités d’un territoire donné, ce qui peut engendrer des incohérences ou des blocages. En somme, la centralisation à outrance, héritée de l’histoire administrative française, crée un frein invisible : un manque de réactivité et de souplesse dans le pilotage des projets industriels.
Un labyrinthe administratif décourageant
Au-delà de la centralisation, la complexité administrative elle-même est un véritable parcours du combattant pour tout investisseur industriel. Obtenir les autorisations nécessaires pour ouvrir ou étendre une usine en France relève du casse-tête. Les procédures sont nombreuses, techniques et successives : étude d’impact environnemental, enquête publique, fouilles archéologiques préventives, permis de construire, raccordements divers... Chaque étape prend des mois, et les délais s'additionnent. En moyenne, il faut plus d'un an (souvent 17 à 18 mois) pour qu’un projet industriel obtienne le feu vert administratif en France, contre quelques mois dans d’autres pays européens. Ce fossé temporel est édifiant : pendant que la France fait patienter un industriel pendant un an et demi, l’Allemagne ou la Suède peuvent finaliser un projet en moins de six mois. Le coût de cette lenteur est rédhibitoire. Pour une PME, chaque mois perdu engendre des frais sans production en face : des études complémentaires, des financements qui courent, du matériel inutilisé... Selon certaines estimations, un retard de huit mois sur un projet industriel moyen peut coûter près d’un million d’euros à une entreprise de taille moyenne – de quoi faire capoter sa décision d’investir. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que nombre d’industriels jettent l’éponge ou choisissent des destinations perçues comme plus « business-friendly ».
Des projets d’usines avortés par excès de bureaucratie
Les lourdeurs administratives, couplées à la centralisation, ont déjà fait rater de belles opportunités à la France. Ces dernières années, plusieurs projets majeurs ont échappé au territoire national, en partie à cause de la difficulté à s'implanter rapidement :
Un grand constructeur automobile étranger a choisi l’Allemagne plutôt que la France pour bâtir sa gigafactory de véhicules électriques, séduit par des procédures plus rapides outre-Rhin.
Un leader mondial des semi-conducteurs a initialement envisagé une usine en France, avant de se tourner vers un pays voisin offrant un environnement administratif plus réactif pour son méga-projet.
De même, des entreprises innovantes dans les batteries et l'électrique (gigafactories, sites de production de batteries) ont préféré s’établir ailleurs en Europe, percevant la France comme un terrain trop complexe administrativement.
Dans chaque cas, le constat est amer : la centralisation des décisions, l'empilement des dossiers à remplir et la lenteur des retours ont découragé l’investissement. Et il n’y a pas que les géants étrangers : de nombreux industriels français renoncent eux aussi à agrandir une usine ou à lancer un nouveau site, faute d’avoir la patience (ou les moyens) de naviguer des mois dans les méandres bureaucratiques. Certes, l’État a commencé à réagir – on parle de simplifier les normes, d’accélérer les procédures via une récente loi “Industrie verte”, ou de créer des sites industriels “clés en main” dispensant une partie des démarches. Mais sur le terrain, ces avancées peinent encore à se traduire en réalité palpable. Tant que le millefeuille administratif ne sera pas allégé et que les territoires n’auront pas plus de latitude, la réindustrialisation restera freinée. Lever ces obstacles invisibles mais bien réels est indispensable pour redonner envie aux industriels d’investir en France, et pour que les projets d'usines cessent de s'enliser dans les papiers au lieu de voir le jour.
A venir Décentraliser l’industrie – La clé du succès
Publié le 31 mars


